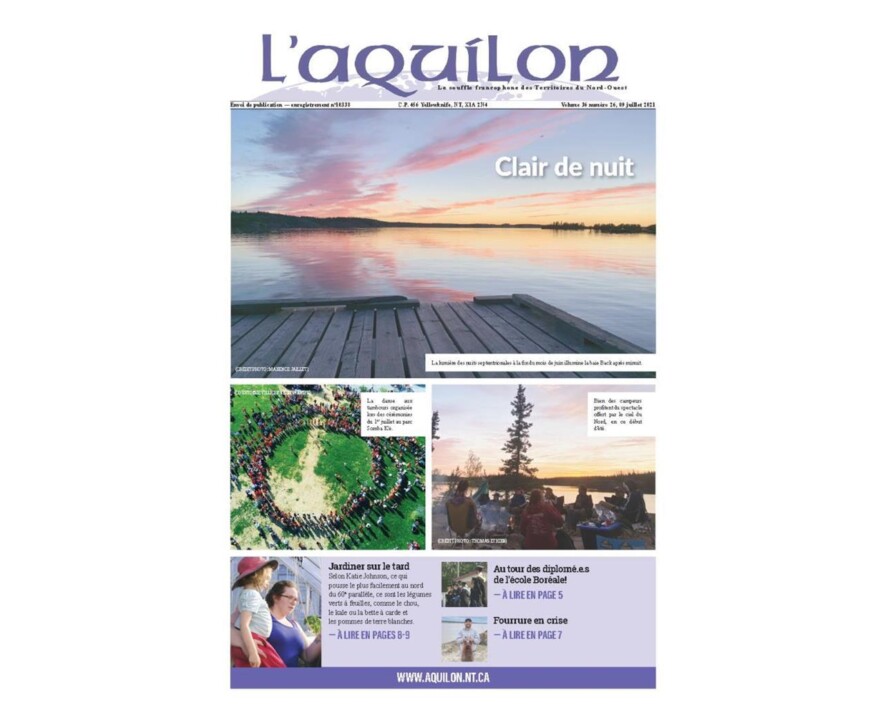Il n’y a malheureusement pas d’érables partout au pays, ça n’a pas empêché les nations autochtones de produire au fil des générations, un sirop issu de la sève des arbres. Sous l’initiative de Mike Mitchell, un intervenant d’expérience, et de Stéphane Millette, professeur des élèves de 7e,8e et 9e à l’école, les classes francophones ont découvert tout le processus de production du sirop de bouleau.
Depuis plus d’une vingtaine de jours, les taches se sont succédé pour les élèves plus âgés de l’école. Tout d’abord, ils ont appliqué les rudiments de la biologie végétale en comprenant le phénomène de la montée des sucs. Chacun a ainsi entaillé un arbre qu’il a soigneusement choisi : ni trop gros, ni trop fin. D’après leurs connaissances, il faut au moins que le bouleau ait un diamètre de huit centimètres pour qu’il soit un bon producteur de sève. À la place de la simple entaille faite à la hache, pratique utilisée chez les Premières nations, et du goulot en métal utilisé parfois pour l’érable, c’est un chalumeau en plastique qui a été préféré pour récolter le liquide végétal, empêchant selon leur dire que la cicatrice ne s’oxyde par la suite.
Le professeur commente l’implication de ses élèves : « Je pensais vraiment développer chez eux un intérêt particulier avec cette activité. Leur faire profiter d’une tâche routinière et journalière au milieu de leur cours. Ils étaient très intéressés à apprendre toutes ces choses mais un peu moins à les faire. En fait ce qu’ils ont préféré dans tout ce processus d’éducation, c’est le rôle de moniteur qu’ils ont assuré auprès des plus jeunes classes. »
Chaque élève de 7e, 8e et 9e année a amené un groupe d’autres élèves sur le site de récolte pour lui expliquer le projet développé et ce qu’ils avaient retenu de cette expérience. Des notions comme les 100 litres de sève qu’il faut récolter pour obtenir un litre de sirop de bouleau. La répartition de ces feuillus jusqu’à la ligne des arbres de la forêt boréale. Le printemps qui est le meilleur temps pour récolter les sucs juste quand l’arbre remet en circulation ses nutriments pour son futur bourgeonnement. Les bienfaits naturels de l’eau de bouleau, qui peut servir de substitut quand l’eau potable est turbide après le dégel.
Ensuite viennent les différentes étapes de finition du sirop. C’est le moment que les élèves ont pour rédiger leur remue-méninges, et leur texte de rédaction sur les outils et les étapes de cette production. Ils se rassemblent tous autour du champion pour la première ébullition à l’extérieur. Dans les effluves de la vapeur d’eau de bouleau, ils apprennent que l’ébullition permet d’éliminer les bactéries et que ce liquide en concentrant ces sucres va devenir de plus en plus foncé. Enfin après cinq heures de réduction, c’est la seconde étape de finition qui s’effectue sur plus de 24 heures. Dans un chaudron sous une température constante de 93°C, le sirop va se réduire encore et atteindre le taux de glucose désiré.
Millette conclu l’expérience avec une dégustation de sirop sur des bagels en précisant qu’il ne faut pas se faire d’illusion : « le taux de sucre est très différent du sirop d’érable qui rend les crêpes si bonnes. Mais que si l’on n’ajoute aucun fructose comme le veut la tradition ça reste un très bon nappage pour la crème glacée! »