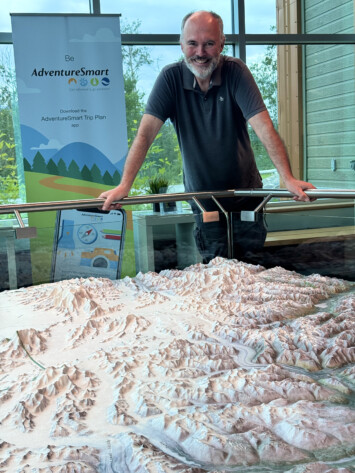
Michel Baraër, professeur à l’École de technologie supérieure de Montréal, étudie les impacts du changement climatique sur l’hydrologie des glaciers du parc national Kluane au Yukon.
Afin de souligner l’année internationale de la préservation des glaciers déclarée par l’Unesco, Parcs Canada a organisé un cycle de conférences durant la saison estivale. Des sujets en lien avec les glaciers et le réchauffement climatique sont abordés, chaque mercredi, au centre culturel Da Kų, à Haines Junction au Yukon.
Même si mettre de l’avant la préservation des glaciers permet d’exporter un message au grand public, Michel Baraër estime cependant qu’il est trop tard, car la fonte des glaciers et leurs impacts sont connus depuis très longtemps.
« C’est toujours bien d’avoir de l’exposition, de pouvoir parler des glaciers, et de ce qu’ils représentent, mais aussi de les voir comme des signes annonciateurs de ce qui pourrait se passer par la suite. Mais c’est sûr que la communauté de glaciologues aurait aimé en parler il y a 30 ans », explique le professeur lors d’une entrevue.

M. Baraër rappelle que, malgré la disparition inéluctable des glaciers, les capacités des scientifiques à faire des prévisions sont limitées.
Apprendre sur les glaciers
Pour Katarina Welsch, coordonnatrice d’interprétation pour le parc national Kluane, la déclaration de l’Unesco est une bonne occasion pour que Canadiens et Canadiennes, mais aussi les touristes de passage, à en apprendre davantage sur les glaciers, sur la recherche, les partenaires de recherche et les actions prises pour préserver les glaciers. « On essaie d’éduquer le public avec des programmes comme ça et partager le savoir des glaciers. Je trouve ça super intéressant personnellement et, comme notre parc est composé de tellement de glaciers, je trouvais ça super important de pouvoir partager cette information-là. »
D’une superficie de 22 000 km², le parc Kluane est situé dans le sud-ouest du Yukon et fait partie d’un ensemble transfrontalier classé au patrimoine mondial de l’Unesco, incluant également des parcs en Colombie-Britannique (Tatshenshini-Alsek) et en Alaska (Wrangell–St. Elias et Glacier Bay). Il abrite notamment le mont Logan, le point culminant du Canada qui s’élève à 5 959 m.
Dans une publication de mars 2025 du Courrier de l’Unesco titrée Glaciers : Chronique d’une fonte annoncée, la rédactrice en chef, Agnès Bardon, rappelle que la fonte des glaciers est lourde de conséquences et génère, entre autres, des dérèglements du cycle de l’eau et une élévation du niveau de la mer. « Les mutations qui s’opèrent aujourd’hui sur les sommets, dans des zones souvent reculées et difficiles d’accès, peuvent paraitre lointaines et localisées. C’est tout le contraire. Ce qui se joue aujourd’hui dans les montagnes, véritables sentinelles du changement climatique, a des conséquences sur la qualité de vie dans les vallées, les zones côtières et les villes. En un mot, sur notre futur », pense-t-elle.
Les glaciers représentent un équilibre fragile, selon M. Baraer, et tous les glaciers ne sont pas logés à la même enseigne. Les petits glaciers, qui se trouvent en périphérie du massif Kluane, sont affectés de façon plus forte par le réchauffement climatique que les glaciers qui se trouvent sur la calotte glaciaire, à plus de 2 000 mètres d’altitude.
« C’est sûr qu’on va vers la disparition des petits glaciers et la transformation des plus gros. Jusqu’où ça ira ? Ça dépasse un peu la capacité réelle de prédiction des scientifiques », estime M. Baraër.

Des tempêtes de sable provenant des rives du lac Kluane affectent non seulement les collectivités, mais aussi la faune.
Protéger la biodiversité
Alors que la disparition des glaciers à plus ou moins long terme est inéluctable, Mme Welsch rappelle que des actions, prises conjointement avec les Premières Nations de Kluane et Champagne & Aishihik qui cogèrent le parc, sont mises en place en fonction des observations sur le terrain. Par exemple, certains sentiers ont été fermés au public au début de la saison estivale afin de protéger les mouflons de Dall qui paissent dans les prairies alpines.
« On sait qu’il y a beaucoup de stress causé par les changements climatiques en ce moment et on essaie d’éliminer les stress qui ne sont pas reliés aux changements climatiques. Pour rendre les mouflons plus résilients, on a décidé de fermer l’accès au mois de mai et début juin quand ils ont leurs petits. »
Avoir un réseau d’aires protégées partout au Canada est fondamental, selon la coordonnatrice d’interprétation du parc, et permet de faire face aux effets des changements climatiques. « On parle d’une solution axée sur la nature. Donc, pour être sûr que la biodiversité est protégée et que les écosystèmes restent sains et résilients, Parcs Canada travaille avec les chercheurs et les Premières Nations pour observer les changements qui se passent et faire de l’éducation auprès du public », conclut-elle.
De multiples conséquences
En mai 2016, le niveau du lac Kluane, qui se trouve au nord du parc, a chuté d’environ deux mètres, après le détournement soudain de ses eaux, en l’espace de quelques jours. Ce changement, dû à la disparition de la rivière Slims (A’ăy Chù), son principal apport d’eau provenant du glacier Kaskawulsh, a créé un nouveau canal vers le sud, déviant ainsi tout l’écoulement vers l’océan Pacifique plutôt que vers le lac. Aujourd’hui, le sable de ses rives, soulevé par le vent, entraine des tempêtes qui affectent non seulement les collectivités, mais aussi la faune.
« C’est devenu super poussiéreux et ça a changé le paysage. On travaille avec des experts pour étudier ce genre de changement. Non seulement les glaciers diminuent, mais ça affecte aussi les populations locales et les animaux », détaille-t-elle.
Des scientifiques fatalistes ?
Il y a dix ans, la communauté scientifique tirait la sonnette d’alarme lors des conférences et des publications de rapports, se souvient M. Baraër. Aujourd’hui, les constats s’accumulent et le fatalisme a remplacé les déclarations alarmistes.
Les coupes budgétaires du gouvernement fédéral ajoutent une difficulté supplémentaire aux équipes de scientifiques. Ces derniers n’ont pas toujours les moyens financiers de relever les données de leurs stations météo et faire les observations et mesures nécessaires à la documentation des effets du réchauffement climatique.
M. Baraër déplore cette situation qui amène son lot de frustration parmi la communauté scientifique. « Quand on voit que la glace fond de tous les côtés, on en est témoin, on est équipé, on est capable de rapporter tout ça. Mais l’indifférence dans laquelle on travaille est aussi dommageable que le manque de moyens », conclut le spécialiste de l’hydrologie alpine et nordique.
Articles de l’Arctique est une collaboration des cinq médias francophones des trois territoires canadiens : les journaux L’Aquilon, L’Aurore boréale et Le Nunavoix, ainsi que les radios CFRT et Radio Taïga.










